Faire des listes
Il y a dans la composition de listes une sorte d’arbitraire magique, comme si le sens devait surgir de la seule association. (Alberto Manguel)
Trouvé dans Journal d’un lecteur d’Alberto Manguel au moins trente listes évoquées ou détaillées, recueillies ou composées par l’auteur.
1 - Une liste nostalgique de ce que la patrie représente pour le narrateur de L’Invention de Morel faite d’une énumération de lieux, de gens, d’objets, d’instants, d’actions (p. 30)
2 - Une liste de souvenirs qui évoquent Buenos Aires à l’auteur (p. 30, 31)
3 - Une liste des papiers qui s’échappent de ses livres tandis que Manguel les époussète (p. 36)
4 - Une liste des qualificatifs applicables à la cité idéale d’Aristote (p. 47)
5 - Une liste de savants fous suivie d’une liste de savantes folles (p. 51, 52)
6 - Les listes de Kipling —Choisis avec soin, les noms de personnes, d’aliments, d’objets, de pierres précieuses et de vêtements sont énumérés, page après page, avec la délectation d’un poète. (p. 61)
7 - Kipling toujours, les listes détaillées dont il se sert pour décrire la Maison des Merveilles dans Kim (p. 61)
8 - Une liste des objets offerts à l’auteur et qui se trouvent dans la pièce où il écrit (p. 71)
9 - Une liste des objets que Kipling conserve sur son bureau et qu’il a répertoriés dans son autobiographie (p. 72)
10 - Une liste de coïncidences littéraires (p. 104, 105)
11 - Une liste des romans policiers préférés de l’auteur (p. 105, 106)
12 - Une liste des rues de Londres aperçues par Sherlock Holmes depuis la fenêtre de son fiacre et qu’il repasse dans sa tête (p. 110)
13 - Une liste de bibliothèques imaginaires (p. 110)
14 - Une liste de bibliothèques de livres réels mais lus par des auteurs imaginaires (p. 110, 111)
15 - Une liste des livres empilés à côté du lit de l’auteur (p. 139)
16 - Une note sur l’utilité de dresser une liste de choses qui n’ont pas réellement d’importance (p. 146)
17 - Une liste des poètes bons et mauvais écrite par Cervantès dans Voyage au Parnasse, et le recensement de la bibliothèque de Don Quichotte par ceux qui s’apprêtent à la brûler (p. 174)
18 - Une liste des mémoires et journaux intimes contenus dans la bibliothèque de l’auteur (p. 176, 177)
19 - L'évocation d’une liste établie par l’auteur et qui serait celle des endroits où il pourrait vivre heureux (p. 179)
20 - Une liste de quatre expériences climatiques mémorables vécues par l’auteur (p. 180)
21 - Une liste des villes favorites de l’auteur (p. 183, 184)
22 - Quelques listes de livres, composées durant un voyage en avion — sur le thème du temps suspendu — sur les lieux qu’on ne peut pas quitter — sur les lieux qu’on ne peut atteindre (p. 186, 187)
23 - Une liste des moments de bonheur inattendus (p. 197)
24 - Les 164 listes des Notes de chevet de Sei Shônagon — C’est le parfait livre à lire en ces temps de fragmentation (p. 198)
25 - Une liste de livres que l’auteur aimerait posséder pour des raisons anecdotiques — sa bibliothèque sentimentale (p. 201, 202)
26 - Une liste de héros littéraires composée pour un éditeur (p.205)
27 - Une liste de sujets poétiques selon Sei Shônagon (p. 205)
28 - Une liste des choses qui donnent une impression de malpropreté à Sei Shônagon (p. 205, 206)
29 - Une liste de sujets malpropres selon Albucius Silus en réponse à une question du père de Sénèque telle que l’a rapportée Pascal Quignard (p. 206)
30 - Une liste de suggestions pour une anthologie sur le thème de l’insomnie (p. 229, 230)
Alberto Manguel, Journal d’un lecteur, Actes Sud, Oct. 2004

































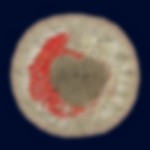


![Elisabeth Vu, carnets – la peau des mots […] Greffe de peau – Peau cousue, cicatrices – Plis et replis, secrets enfouis – encre, sang, peau tatouée […]](https://www.lesmetamorphosesdelasole.eu/thumbs/home/inventaire-tatoo/inventaire-tatoo-note-110x150-blur.jpg)
![Elisabeth Vu, carnets – naissance du langage selon un conte Dogon […] Le génie déclamait et toutes ses paroles colmataient les interstices de l'étoffe. […]](https://www.lesmetamorphosesdelasole.eu/thumbs/home/conte-dogon/conte-dogon-169x150-blur.jpg)




![Elisabeth Vu – Romances, Ex-voto et Images Modestes […]La petite image avait été collée sur un carton gris peut-être habillé d’un reste de papier peint[…]](https://www.lesmetamorphosesdelasole.eu/thumbs/home/les-images-modestes/absence-fond-bleu-use-112x150-blur.jpg)
![Elisabeth Vu – Romances, Ex-voto et Images Modestes […]La petite image avait été collée sur un carton gris peut-être habillé d’un reste de papier peint[…]](https://www.lesmetamorphosesdelasole.eu/thumbs/home/les-images-modestes/absence-papier-fleurettes-113x150-blur.jpg)
![Elisabeth Vu – Romances, Ex-voto et Images Modestes […]La petite image avait été collée sur un carton gris peut-être habillé d’un reste de papier peint[…]](https://www.lesmetamorphosesdelasole.eu/thumbs/home/les-images-modestes/absence-medaillon-2-113x150-blur.jpg)

